J’aimerais être franche, pouvoir dire que je suis schizophrène et que les gens le comprennent
Je passe la majorité de mon temps perdue quelque part dans ma tête. Je suis suspicieuse et convaincue, surtout la nuit, que quelqu’un me poursuit. Bien des fois je me sens importante, puisque j’ai l’impression qu’il y a des gens qui me regardent de différents endroits. Lors d’un échange, j’ai le sentiment constant que je sais ce que tu penses. Certaines histoires je les interprète comme signes dont le but est de me transmettre quelque chose. J’ai la schizophrénie et tout ce qui m’entoure se trouve derrière un écran fabriqué par mon cerveau.
Auteure anonyme
Illustration par Naomi Bîldea
Publié: [wpdts format= »j.n.Y » start= »post-created »]Quand j’avais dix ans, deux hommes ont déménagé dans la maison d’à côté. Un jour, quand je rentrais de l’école, je me suis arrêtée au passage piéton, les deux étaient derrière moi et ils se sont montré quelque chose, l’un à l’autre. J’étais persuadée qu’ils analysaient ma taille faisant secrètement le projet de m’enlever. Je suis rentrée chez nous, j’ai raconté aux parents et papa m’a suivie, à mon insu, quand je revenais de l’école et il a pris quelques photos des voisins. Plus tard il me l’a raconté, me rassurant qu’il n’y eût rien à craindre.

Je me suis rappelé cette histoire puisque c’est alors que j’ai partagé pour la première fois mon inquiétude. Mais les situations et les histoires que je considérais vraies ne reflétaient pas la réalité. Quand j’avais neuf ans, j’étais convaincue que les vacances planifiées par mes parents étaient un piège dont eux-mêmes ils ne s’en rendaient compte et que nous allions tous mourir en route. Je n’ai partagé avec personne mes réflexions, même s’il y a eu des situations quand j’avais l’impression que quelqu’un me piégeait ou que j’allais être enlevée. J’ai évité des gens et des situations douteuses et je suis parvenue à croire que je leur ai échappé uniquement grâce à ma prudence. Bien des fois, y compris à présent, je me demande si ces inventions étaient uniquement dans mon imagination d’enfant, puisqu’elles semblaient bien réelles.
En Ve(1), je me suis mise à fabriquer des histoires. La réalité, écrasante à l’époque, a contribué à mon évasion dans l’imagination. Papa ne me laissait pas m’acheter de fringues neuves, disant que j’en avais assez, il ne me laissait pas utiliser l’Internet ou me défendait de me laver les cheveux plusieurs fois par semaine. Pour mes parents, l’école était la plus importante, ce qui ne me dérangeait pas puisque j’étais curieuse et compétitive. Pour eux, les prix et les bons résultats scolaires étaient quelque chose de normal et ils ne se montraient pas fiers de moi. Alors, moi je ne comprenais pas ce que je ne faisais pas bien et je me mettais à travailler davantage pour me faire remarquer. Toutes mes copines avaient un petit ami. Pas moi. Et ce manque de confiance, l’impuissance de parler avec les autres m’a menée, crois-je à présent, à me construire une réalité parallèle.
Je recevais des rôles (je ne sais pas d’où), mais il fallait que j’interprète un tel rôle. C’est comme si t’as une idée, sauf que moi, je ne pensai à rien, l’idée surgissait, c’est-à-dire le rôle. Après l’avoir reçu, je m’enfermais dans la chambre et je me mettais à gesticuler et à parler à haute voix, je m’imaginais la réaction des autres personnages et j’entendais leurs réponses, que je contrôlais. Le rôle devait être parfaitement interprété.
En général, j’étais un héros qui recevait la reconnaissance des autres, quelqu’un avec beaucoup d’amis, marrant et intéressant. Je débranchais de la réalité jusqu’au moment où maman m’appelait, par exemple, à table. Les situations n’étaient pas toujours heureuses, des fois je m’imaginais la mort de quelqu’un et j’étais triste toute la journée.
Quand quelque chose de désagréable arriva en réalité, j’allais à la maison, je me renfermais dans ma chambre et je revivais la situation, en la modifiant à mon goût. Après une période, j’avais du mal à contrôler ces inventions. Je savais qu’elles étaient imbriquées dans mon imagination, mais je ne pouvais plus contrôler l’histoire. J’étais consciente du fait que je parlais seule dans la pièce, mais bien des fois je ne pouvais pas m’empêcher, même si j’avais des devoirs, même si le matin je devais aller à l’école. Je préférais dérouler l’histoire et m’absenter au premier cours ou arriver en retard. Il y avait des jours (qui par la suite se transformeront en semaines) en fin desquels je me rendais compte que j’avais été assise sur une chaise dans ma chambre et que j’avais vécu « les événements » dans ma tête.
« J’ai complétement perdu confiance en moi et dans la notion de famille – je croyais qu’il n’y avait pas de famille où ça allait »
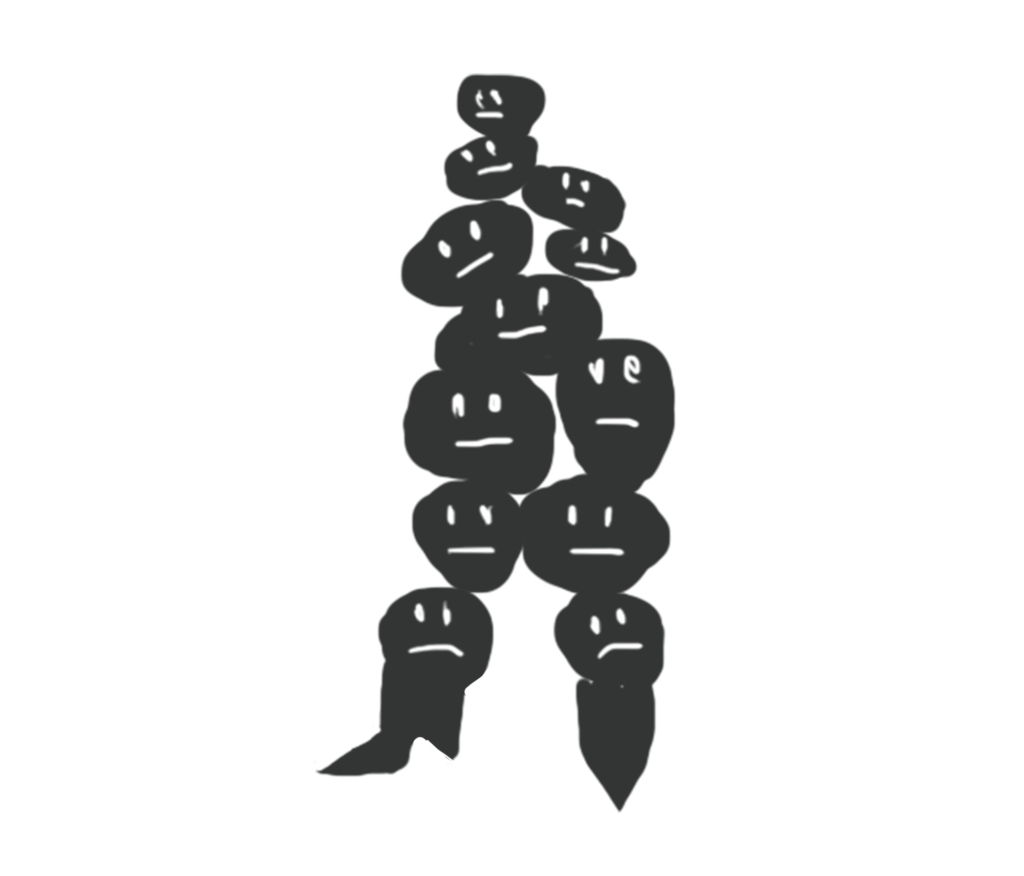
Après un temps, la frontière entre imagination et réalité s’est estompée. En VIe(2), je croyais que j’étais surveillée par des caméras à la maison, à l’école et dans la rue et je me comportais comme si j’étais filmée : je faisais attention à mes pas, à ma posture, à la direction de mon regard, à la manière de m’habiller. Je me sentais importante. Je prenais certains incidents pour des signes. Si papa butait avant d’aller quelque part en voiture, j’étais convaincue qu’il ne fallait pas partir puisque nous allions mourir.
Fin de la VIIIe(3), début de la IXe(4), il y a eu des épreuves qui m’ont fait m’enfoncer dans mes histoires inventées. Ma cousine, avec laquelle j’avais été toujours comparée, tua sa mère, c’est-à-dire ma tante, de manière violente et ceci m’a fait penser que j’allais faire pareil. Mes parents divorcèrent et lorsqu’ils disaient du mal l’un de l’autre, on ne me permettait pas de défendre l’autre.
J’ai complétement perdu confiance en moi et dans la notion de famille – je croyais qu’il n’y avait pas de famille où ça allait. Quand j’allais chez ma collègue et son papa était là, je croyais qu’il juste faisait semblant d’être un bon papa puisque j’y étais, mais une fois partie, certainement il deviendrait agressif comme le mien, que nous prenions pour un objet fragile pour qu’il ne casse. Maman, mon frère et moi nous faisions gaffe à ne pas le déranger et à ne pas faire d’erreur pour qu’il n’éclate pas. Énervé, papa hurlait et jetait des objets partout dans la maison, il me frappait, mon frère aussi, il nous envoyait dans nos chambres et nous punissait.
En VIIIe(5), mes collègues m’ont exclue de leur groupe me reprochant mon un air de supériorité à cause de mes bonnes notes – après quatre ans pendant lesquels ils avaient copié tous mes devoirs ! Encerclée pendant une pause, j’ai écouté chacun dire tour à tour combien ils ne me supportaient plus et que je ne pouvais plus rester dans leur classe. Je ne distinguais plus le bien du mal, je ne comprenais pas comment il fallait être. Je me suis isolée, j’ai refusé de parler et j’ai commencé à avoir des pensées négatives sur moi et je passais mes journées à pleurer. Je ne pouvais pas m’arrêter. Je pleurais quelques heures, jusqu’à ne plus reconnaitre mon visage défiguré par les larmes dans le miroir.
Le matin, j’étais souvent en retard à l’école, car j’étais fatiguée en permanence. Et, des fois, je demandais d’aller aux toilettes pour pleurer. Je sanglotais à cause du divorce de mes parents et du fait que papa m’appelait chaque jour pour me dire combien j’étais bonne à rien, pareille au reste de la famille (maternelle), que je ne méritais rien et que j’allais toujours recevoir rien. Dans le temps, je suis restée avec une voix intérieure qui me répétait de plus en plus souvent que je n’allais pas réussir ma vie, que j’étais embêtante, inutile, que je n’allais jamais m’échapper, que j’allais rester avec mes pensées, que je ne méritais pas de vivre.
Je n’aimais pas aller en vacances avec papa, un alcolo à l’époque, et sa copine. Ils s’en fichaient de nous, les enfants. Et, après quelques verres, ils se moquaient de moi, et surtout de mon frère cadet. A présent, j’ai rompu tout contact avec mon père.
Je pleurais pour peur de ne pas devenir comme ma cousine, avec laquelle j’étais comparée. Quand je ne rangeais pas mes habits, par exemple, maman me disait que j’allais devenir comme elle, désordonnée. Après le divorce, papa m’insultait et me comparait avec elle. Après le crime, je jouais avec mon frère sur le tapis et je l’empêchai de se lever, alors il cria – tout en jouant. Ma grand-mère nous entendit et me dit : « Toi aussi tu veux le tuer, comme ta cousine ? ». Les comparaisons se sont transformées dans une voix qui me disait : « Tu n’y échapperas pas. Il n’y a pas de choix. »

« J’ai demandé de l’aide pour la première fois à la fin de ma première année de fac »
Pleurer est devenu ma seule activité. Y compris à présent, quand j’évoque cette période, je me revois pleurant à la maison, dans les toilettes de l’école, dans la rue, même si je faisais attention pour que personne ne me voie. Je ne sortais jamais, je faisais mes devoirs tard dans la nuit et la réalité ne m’importait plus. La prof de roumain a menacé de me donner une mauvaise note si je continuais à me perdre dans mon monde : à plusieurs reprises je la regardais et je n’entendais pas sa question, même si elle répétait maintes fois mon nom.
A l’époque, je me sentais très seule, je souhaitais parler avec quelqu’un, sans savoir avec qui. J’ai commencé à « opérer » mes jambes (mon jargon à moi). Je tailladais la partie inférieure de mes jambes avec des outils aiguisés, disant que c’était la seule manière de guérir les petites irritations apparues suite aux épilations. L’été entier je ne mettais que de pantalons longs pour que personne ne voie les blessures profondes et longues de mes jambes. Mais c’est seulement avec ces « opérations » que je parvenais à me calmer et à cesser de pleurer.
En fin de lycée, à l’approche des examens, j’ai trouvé le courage de dire à maman que quelque chose n’allait pas. Mais elle m’a dit que c’était à cause du nombre important de devoirs. Sa réponse m’a fait m’éloigner davantage d’elle et m’a convaincue que j’étais complètement seule. J’ai eu mon bac avec une très bonne note et aussi le concours d’admission à la fac que je souhaitais.
Pendant les vacances d’été j’ai commencé à penser au suicide. Maman a eu peur quand je me suis enfermée pendant des jours dans ma chambre refusant d’ouvrir la porte ou de manger. Le même été, quand nous rentrions de la mer en voiture, j’ai ouvert la portière et j’ai essayé de sauter.
La première fois quand j’ai demandé de l’aide c’était à la fin de la première année de fac. Je croyais qu’un nouveau début allait traiter mes problèmes, mais ce ne fut ainsi. Je suis allée voir un psychiatre et je lui ai parlé (mes plus longues et incommodes quelques minutes) de mes problèmes du moment : pleurer, perdre tout intérêt, rester au lit, penser obsessionnellement à la mort et manquer d’appétit. Il ne m’a pas posé de questions et m’a posé le diagnostiqué de dépression.
Les médicaments prescrits ont eu pour effet secondaire la somnolence. Après dormir mal pendant des années, pour la première fois j’ai dormi trois jours d’affilée. Ces jours je devais étudier pour un examen important et moi, je me suis couchée et réveillée après trois jours, le matin de l’examen, bien reposée. Même si je n’ai rien révisé, j’ai réussi l’examen puisque je me suis rappelé l’info des cours. J’ai pris les médicaments pendant quelques mois, sans résultat. Alors j’en ai arrêté. Je ne suis plus allée chez le médecin, puisque chaque fois il me disait : « Une fille si belle que toi ne peut pas se sentir mal ».
Je déambulais dans les rues de la ville où j’avais déménagé pour les études et je songeais dire au revoir à tout. Je ne décrochais pas les appels de maman et, quand elle faisait la distance de 90 kilomètres pour venir me voir, je refusais de la rencontrer. J’avais l’impression qu’avec mes collègues, elle complotait contre moi. Je n’allais plus à la fac. Tout ce que je voulais était d’être laissée tranquille. J’étais méfiante et je déroulais des histoires dans ma tête, mais il me semblait normal qu’il soit ainsi.
Au début, j’aimais la fac et la première année j’ai eu une bourse. Je passais mon temps à la bibliothèque lisant les ouvrages recommandés. Mais, quand les profs demandaient si nous avions lu, je n’avais pas le courage de lever la main ou de donner la réponse quand je la connaissais. Un des cours exigeait aussi des discussions hebdomadaires avec le prof. Et lors de ces échanges le feedback était toujours positif, ce qui me donnait l’impression que les choses allaient s’arranger. Mais, si quelque chose de désagréable se passa, ma mauvaise humeur revenait.
M’imaginer dans un hôpital psychiatrique m’a fait peur, les médicaments aussi. »
Après six moi, je suis allée chez un psychothérapeute (que je continue à voir y compris à présent), où j’ai beaucoup parlé (mais je n’ai rien dit sur mes soupçons et mes impressions d’être suivie, filmée, puisque je pensais que ça était de l’ordre du normal) et, après quelques rencontres, il m’a recommandé un médecin (qui est resté mon médecin jusqu’à présent). Le médecin m’a posé le diagnostic de « trouble psychotique », il m’a prescrit un traitement et m’a conseillée de me faire hospitalisée.
M’imaginer dans un hôpital psychiatrique m’a fait peur, les médicaments aussi. Je craignais que mon cerveau allât se modifier, que ce ne soit plus moi, qu’il n’y ait pas de retour. Quelques jours avant l’hospitalisation, je ne mangeais plus, je tremblais et j’appelais fréquemment le psychothérapeute. Quand une personne passait dans ma proximité, j’avais l’impression qu’elle existait et moi non, que j’étais un fantôme et que les autres ne me remarqueront jamais.
Le jour d’admission a été le jour quand mes collègues de fac sont partis dans une excursion. A neuf heures du mat nous roulions dans sa voiture quand le car avec mes collègues nous a dépassées. Je pensais que ma place était parmi eux, et non pas dans la voiture qui m’emmenait vers l’hôpital psychiatrique. « Je suis saine », je pensais, « c’est moi qui ai tout inventé, je me suis auto-piégée, il faut que je m’en sorte vite ». Je demandai maman si mon admission était une bonne idée, s’il ne fallait pas attendre un peu, même si nous avions déjà eu cette discussion plusieurs fois déjà.
La procédure d’admission a été rapide. Je suis arrivée dans une salle à cinq lits où il n’y avait que moi et une fille dont les docteurs disaient que c’était un cas grave. J’étais terrifiée. Ma collègue avait uniquement une cuillère, un gobelet en plastique, des chaussettes (elle n’avait pas de pantoufles) et un livre de prières. Elle dormait beaucoup à cause des médicaments forts qu’ils lui avaient donnés. Moi j’avais peur d’injections, mais elle s’en fichait.
Maman est partie et je ne comprenais pas pourquoi j’y restais, car j’allais très bien. Maintenant je sais que c’est ainsi que je fonctionnais : je ne montrais à personne comment je me sentais et j’étais gaie quand il y avait d’autres personnes. Ceci a mis en difficulté les médecins à l’hôpital. Je ne parlais avec personne sur mes pensées étranges, puisque je les considérais normales. Je continuais à croire qu’il y avait des caméras partout, et mon rôle était de prouver que j’étais capable de prendre soin de moi, que j’étais joyeuse et empathique et que ma place n’était pas là. Le soir je craignais aller aux toilettes pour peur que les autres patients m’attaquent et le matin ils me trouvent morte. Je ne parlais pas de ça à mon médecin, et le médicament que je prenais ne m’aidait pas.
J’avais l’impression que mon crâne était trop petit pour mon cerveau. Je disais tout le temps que j’avais une sensation d’étau autour de la tête ; ils me répondaient qu’il fallait m’habituer au médicament. Dans l’hôpital psychiatrique où j’étais, les médecins étaient à la recherche des cases où ranger chaque patient. Il n’y avait pas de nuances. Il fallait poser un diagnostic, alors la question n’était pas « Qu’est-ce que tu sens ? », mais « Tu sens ça, n’est-ce pas ? »
J’y suis restée trois semaines et j’ai connu beaucoup de femmes avec des problèmes familiaux (mari agressif, mari parti à l’étranger, dépression post-partum) et avec des problèmes de santé mentale, mais j’ai connu aussi des femmes qui y étaient pour obtenir par la suite une pension d’invalidité. Les jours passaient, une femme venait, l’autre partait, j’allais au magasin ou dans la cour, j’attendais les repas, l’infirmière avec les médicaments, les visites et le programme de sommeil. Tout le temps j’attendais quelque chose à cause des promesses des médecins : « Vendredi, tu pourras partir », « Lundi, tu pourras partir », « Encore un peu et tu pourras partir ».
Je me rappelle les femmes qui, après avoir fini de manger et voyant que je n’avais pas touché mon assiette (je n’avais pas faim lors du chaque repas), disaient : « A nouveau, les portions qu’ils nous donnent sont modestes ». Elles me regardaient et me demandaient : « Tu ne manges plus, toi ? », et moi je leur passais mon assiette. Il y avait des femmes qui fumaient toute la journée ou d’autres qui attendaient que l’ambulance emmène un cas grave et qu’elles s’amusent à regarder le patient hurlant, lorsqu’il était escorté dans une salle.
Après trois semaines, je suis sortie et je suis revenue à la fac. Dans la résidence étudiante je vivais avec une amie qui était au courant de mon hospitalisation, sans connaitre la vraie raison. Pendant l’hospitalisation, j’étais marquée absente à tous les cours. Pour certains, j’ai réussi les examens en fin de semestre, mais il y a eu d’autres auxquels je n’ai pas été autorisée de participer à cause des absences. Et alors, j’ai dû les inscrire à nouveau dans mon contrat de scolarité. Je prenais mon traitement, mais je continuais à ne pas aller bien. Tout me semblait dépourvu de sens et je souhaitais mourir. Je n’arrivais pas à me concentrer quand j’étais au téléphone avec ma mère qui m’appelait souvent.
Des semaines sont passées. Un soir, quand j’étais seule, j’ai fermé mon compte Facebook et j’ai pris plusieurs pilules de celles qui m’étaient prescrites. Je me couchai et m’endormis en pleurant. Le matin je me réveillai avec un mal de crane et avec la déception que voilà je n’arrivais à faire ni même ça. J’attendis le soir pour prendre plus de médicaments, ce qu’ensuite j’ai fait. Je me réveillai avec une migraine encore plus forte et j’avais du mal à bouger. Je voulais mourir, mais ne savais pas comment le faire (j’avais passé en revue toutes les modalités et la conclusion a été que, sur toutes les possibilités, l’overdose était la plus adéquate). Qu’est-ce qu’il aurait pu être facile si je disparaissais tout simplement, sans rien faire.
J’ai eu la chance car ce jour-là j’avais rendez-vous chez le médecin et, lorsqu’il a vu que je n’étais pas bien, il a appelé l’ambulance et je fus à nouveau hospitalisée dans l’hôpital psychiatrique, mais cette fois-ci dans l’unité pour les malades difficiles. On m’a alloué le lit du côté du mur où il y avait la porte et le lavabo. Pour moi c’était le meilleur endroit. L’oreiller était en morceaux de tissu et le matelas courbé et délabré. J’ai reçu une cuillère et un gobelet en plastique. Ils annoncèrent maman qui m’apporta un pyjama et des livres. Ils enlevèrent mon téléphone, mes sandales (elles avaient des lacets) et mon sac à main. Ensuite, ils fermèrent la porte à clé et je me retrouvai dans la salle avec quatre filles.
Je passai deux semaines à l’hôpital et je me dis que si je sortais, je ferai le tout possible pour ne plus jamais y revenir. Le premier soir, ils emmenèrent une fille. Elle consommait de la drogue. Elle a eu le lit à côté du mien. Son papa la piégea lui disant qu’ils allaient faire une balade en voiture, mais il l’emmena à l’hôpital. Deux mecs géants la tenaient utilisant la force, ils l’attachèrent au lit pendant qu’elle hurla à son père le suppliant de l’emmener à la maison, le menaçant qu’il ne sera plus son père. « Comment t’as pu me faire ça ? », cria-t-elle. Son image me terrifia.
Plus tard, cette fille devint mon amie : je l’aidais manger puisqu’elle n’arrivait pas à tenir sa cuillère, je l’aidais fumer elle n’étant pas capable à cause des médicaments forts. Elle avait sommeil tout le temps et une fois, quand elle fumait, s’endormit et ses cheveux prirent feu. Dans la salle, la fumée était interdite, il y avait un signe sur la porte qui l’indiquait. Mais personne ne disait rien quand les patientes fumaient.
Moi, je ne fume pas, mais les autres filles fumaient et elles le faisaient au lit, car on ne nous laissait pas sortir de la salle. Dans la salle de malades difficiles, le luxe était les sachets de café instantané et les cigarettes. La fille qui était devenue mon amie avait des cigarettes dans son tiroir et la nuit, les autres attendaient qu’elle s’endorme pour les lui voler, ce qui n’était pas difficile, car elle dormait toute la journée. Elle se réveillait le soir, pour une heure, pendant laquelle ne cessa pas de demander ses cigarettes. Les filles la convainquaient que sa mémoire la trompait sur leur nombre et elle avait toujours une réserve : les cigarettes que son papa laissait aux infirmiers, alors elle en recevait d’autres.
La jeune qui était à l’autre but de la salle, du côté des fenêtres barrées, chantait. Je me réveillais et l’entendais chanter si beau, c’était la seule chose qui me calmait de temps en temps. Elle m’a raconté combien elle était proche de la nature et comment elle trouvait son harmonie intérieure couchée dans l’herbe en position de fœtus. Elle était très belle aussi et des fois je la percevais comme irréelle.
Le plus difficile à supporter était le passage du temps ; qui ne semblait pas passer, mais s’être arrêté au beau fixe. Les livres ne m’aidaient pas, ni les magazines, ni les rumeurs, ni dormir, ni manger. Maman venait me voir trois fois par semaine. Je pleurais et quelque fois je lui demandais de m’emmener à la maison. Elle me disait que ce serait mieux d’y rester. Je ne supportais pas les hurlements qui venaient de la salle des garçons, l’excès de pain que nous recevions au petit-déj et qui moisissait après un temps, les discussions des filles sur les avortements et les effets secondaires des médicaments.
Un soir, la fille d’à côté, la toxicomane, a refusé l’injection. Les infirmiers semblaient s’en réjouir entendant ce « Non » tranchant. Ils ont souri : « Ah, non ? Attends un peu ». Ils sont sortis et fait venir deux grands aides-soignants qui l’ont prise par la tête, le cou et le reste du corps, l’ont plaquée au lit et lui ont fait l’injection brutalement. Après avoir assisté à cette scène, j’ai développé une peur si grande envers les injections que j’ai du mal à voir une seringue, y compris dans les films.
Pendant que j’étais hospitalisée, j’ai discuté avec le psychologue de l’hôpital et cela m’allait puisque j’ai reçu des explications à des pensées que j’avais. Le médecin voyait les patients uniquement cinq minutes par jour. Pour le reste, nous étions enfermés dans une salle surveillée par des caméras, avec des barres et beaucoup de fumée. Les jours passés à l’hôpital m’ont aidé uniquement à apprendre le diagnostic et le traitement. Mais, ce qui a suivi n’a pas été un trajet linéaire (il y a, en permanence, des hauts et des bas). Je vais mieux, mais j’ai toujours des moments quand j’invente des histoires ou je parle seule, j’ai des épisodes dépressifs, je suis méfiante et j’ai l’impression d’être filmée. Pendant l’hospitalisation, le médecin a prononcé pour la première fois le diagnostic schizophrénie, il n’en était pas encore certain.
« Le médecin a augmenté ma dose puisque mon état se dégradait à nouveau, et moi, je rentrais chez moi et je parlais à haute voix pour aller mieux. »
Maman a eu du mal à accepter et à s’habituer à l’idée de ce diagnostic. Après deux ans et beaucoup de discussions avec mon médecin, j’ai reçu de manière officielle ce diagnostic. A l’hôpital, je ne suis plus revenue en tant que patiente, mais après trois ans j’ai eu mon papa hospitalisé là-bas, à cause de l’alcool. Pendant que j’attendais le médecin, une des femmes avec lesquelles j’ai été hospitalisée pour la première fois sortit, mais elle ne m’a pas reconnue.
Après la décharge, j’ai commencé à croire que j’allais être punie pour ne pas apprécier la vie que j’avais. J’étais convaincue que j’allais mourir avant la fin de l’année, qu’il me restait donc sept mois. Je me réveillais chaque matin avec cette crainte et tout était suspect : le tour inattendu en voiture, la sortie en ville jusqu’au tard dans la soirée, l’excursion à la mer. Tout le temps, je me disais, ça y est. Le dernier soir de l’année, à minuit, je me suis mise à pleurer pensant que je m’y suis échappée. Je me suis promis que j’allais apprécier ce qui m’entourait. Dans cette période, j’ai déménagé. J’ai pris seule un loyer.
J’ai commencé à sortir en ville, à rencontrer des garçons et la fac, pour laquelle j’avais eu l’habitude de travailler beaucoup, est passée en deuxième plan. C’est alors que j’ai rencontré un jeune avec lequel j’ai eu une relation plus longue, le premier auquel j’ai parlé de ma maladie. Cela n’a pas marché, chaque fois quand je n’allais pas bien, sa réponse était : « Nous sommes tous comme ça, nous tous nous avons des problèmes, arrête de te plaindre ». Je me disais qu’il avait raison, que je me plaignais tout le temps, qu’il fallait aller à l’examen même si je n’allais pas bien. Mais je n’arrivais pas à me concentrer, je sentais le chaos et le bruit dans ma tête, la présence constante des pensées que je n’allais pas réussir. Je leur criais de disparaitre, mais cela ne marchait pas et alors je me mettais à pleurer et à ne plus parler à personne jusqu’à ce que j’allasse mieux.
Le médecin a augmenté ma dose puisque mon état se dégradait à nouveau, et moi, je rentrais chez moi et je parlais à haute voix pour aller mieux. En toute franchise, c’était difficile pour moi à la fac. Quand j’étais chez moi et je devais me concentrer à ce que je lisais, mes pensées me distrayaient. C’était une lutte dans ma tête entre ce dont j’étais censée de faire et la tentation de partir dans une réalité que j’inventais. Je m’endormais sur le carrelage de la salle de bain, je me réveillais la nuit et je me mettais à pleurer : « Que ferai-je ? », « Comment aller dans cet état à l’examen ? », « Je ne saurai rien ». Le matin j’allais à l’examen, je ne savais pas la réponse ou mon devoir ne respectait pas la date butoir, je rentrais, je recommençais à parler à haute voix et je me disais : « Non, non, arrête ! D’accord, encore un peu, encore un peu ! »
Le temps passait, un autre examen venait, j’avais honte d’y aller sans maitriser les sujets. Je me demandais : « Ça fait combien de temps depuis que je n’ai pas dormi ? Depuis que je n’ai pas mangé ? Depuis que je n’ai pas fait le ménage ? Depuis que je n’ai pas ouvert la fenêtre ? Depuis que je n’ai pas appelé maman ? Ah, elle m’a appelée hier soir, mais je n’ai pas décroché puisque son coup de fil ne rentrait pas dans mon histoire ».
Avec le temps, les examens échoués devenaient de plus en plus nombreux. J’ai commencé à me détester. J’avais la sensation que tout le monde me mentait, qu’ils étaient tous contre moi. J’étais convaincue que j’allais être abandonnée ou trompée, puisque les gens allaient voir qui j’étais, au fait. Je soupçonnais aussi ma famille et ni à présent je n’ai réussi à m’échapper à ces pensées. Chaque petit ami était suspect et chacune de ses connaissances ou chaque membre de sa famille, pareil. Ainsi, toutes les relations que j’avais me fatiguaient.
Deux de mes copains étaient au courant du diagnostic. J’ai essayé parler de ma maladie à une connaissance de mon copain de l’époque. Elle m’a dit que je pouvais me passer de parler sur ma maladie, puisqu’il s’en était déjà occupé : il avait dit à tout le monde que j’avais des tumeurs ovariennes et c’est pour cela que je prenais de pilules.
Il y a un an, j’ai eu une très bonne période puisque je prenais le médicament adéquat, dans le bon dosage (Seroquel XR 400 mg, 2 pilules). Mais, après quelques mois, j’ai appris qu’il serait retiré du marché roumain et que je pourrais m’acheter uniquement la version roumaine (Uniquet). Oui, c’est le même médicament, mais l’effet n’est pas le même. Seroquel m’aidait à bloquer complétement les pensées automatiques, les soi-disant histoires inventées, et à dormir. Quelques mois ont suivi quand j’ai vidé les stocks des pharmacies. Ensuite, je suis passée à la version roumaine que je prends y compris à présent (elle m’aide à bien dormir et à ne pas parler avec moi autant qu’avant, et quand je commence à parler, je me rends compte que je suis seule). L’alcool associé à ce médicament est contrindiqué, mais des fois je ne peux pas m’empêcher. Si je les mélange, j’ai sommeil. Mais j’ai si sommeil que je me suis endormie à la table, dans un bar, je me suis assoupie dans les toilettes d’un bistro ou même en dansant, dans un club.
Évidemment, tout le monde croyait que j’avais trop bu. Je n’ai parlé à personne sur les médicaments que je prenais, sur l’hospitalisation ou sur comment je me sentais. C’est uniquement la famille qui est au courant, et le diagnostic ce n’est que maman qui le sait. Je suis parvenue à avoir une relation ouverte et honnête avec elle et avec mon frère, ce qui nous aide. Nous n’avons pas de sujets tabous et, même si on s’engueule de temps en temps ou nous ne sommes pas du même avis, en fin de compte nous trouvons une solution. Maman est la première personne avec laquelle je partage mes états d’esprit. Elle n’aime pas me sentir distante, mais elle ne met pas la pression. Elle a beaucoup de patience et alors, je trouve le courage de lui en parler. Il y a des moments quand elle ne sait quoi me conseiller, ce qui m’énerve puisque je m’attends qu’elle sache traiter tous les problèmes. Des fois je l’insulte et pour un instant, je suis contente de l’avoir fait. Mais ensuite je culpabilise et je m’excuse (pas chaque fois, malheureusement).
« Bien des fois je souhaite renoncer à la vie, et quand cette pensée disparait, elle est remplacée par l’idée que je vais mourir puisque de toute façon c’est ce que j’ai souhaité »
C’est compliqué de suivre le traitement quand je suis en ville, avec d’autres personnes autour de moi. Je dis que ce sont des vitamines ou des pilules contre des douleurs menstruelles, ou bien contre de maux de tête ou un rhume. J’évite les questions des gens, je réponds tout le temps avec une autre question, le temps pour les gens d’oublier leur question initiale. Lors de quelques festivals ils ont pris les pilules que je gardais dans une ancienne boîte à bonbons pour des drogues et ils les ont jetées à la poubelle.
A cause des médicaments, je dors beaucoup et profondément. Les amis me disent que je suis paresseuse, difficile, et bien des fois ils se fâchent puisque je ne suis pas capable de me réveiller. Et moi, je ne dis rien, pour ne pas être obligée à donner des explications. Il me faut des heures pour me réveiller. Toutes les cinq minutes mon réveil sonne pendant deux heures. Maman aussi m’appelle toutes les dix minutes pendant une heure. Et malgré tout ça, il y a eu des fois quand j’ai été en retard.
Si je dors peu, j’ai si sommeil qu’il m’est arrivé de tomber dans les escaliers. Si le soir je ne prends pas le médicament, je ne peux pas dormir. Lors des examens, il fallait que je finisse un projet important. Cela était possible si j’y travaillais pendant la nuit. Sachant que si je ne prends pas le médicament, je ne peux pas dormir, j’en ai profité. Et je n’ai pas dormi pendant 85 heures. A la fin, on ne me reconnaissait plus : je transpirais, mais j’avais très froid, mon cœur battait bien fort, je pleurais pour tous les riens (j’ai pleuré quand le crayon est tombé par terre), je tremblais, j’hallucinais et je percevais le monde comme s’il était au fond d’un tunnel qui s’ondulait en permanence. J’avais besoin de fermer les yeux, mais alors j’avais l’impression de me noyer, d’avoir le monde tourner avec moi et je devenais malade. Tout est passé dès que j’ai pris le médicament à nouveau.

J’ai les médicaments en chaque pièce et en chaque sac à main, et à sept heures du soir je les prends chaque jour. Ce que j’aime le plus est la sensation qui s’installe après trois heures. Je deviens calme et lente, j’ai besoin de quelques minutes pour arriver à bouger ma main, tout inquiétude disparaît et j’ai l’impression de flotter. Avant, je prenais un autre médicament aussi, mais il a fallu que j’arrête à cause des effets secondaires : la main et la jambe gauche avaient des spasmes bien forts et involontaires pendant la journée et je n’arrivais pas à contrôler mes yeux, je ne pouvais pas regarder dans la direction souhaitée.
A présent, j’ai le diagnostic de schizophrénie indifférenciée. Une partie de symptômes a disparu avec le traitement. Mais, quand je rentre le soir chez moi, je crois toujours être poursuivie. Je suis convaincue que celui derrière moi veut m’attaquer. Des fois, je me mets à courir, je me cache, je compose le numéro 112. Je me fais la stratégie de ne marcher ni trop rapidement, ni trop lentement. Si je parle avec quelqu’un au téléphone quand je suis en route vers chez moi, j’ai toujours peur, je n’entends plus ce que l’on me dit et je pense à toute sorte d’option pour m’échapper.
Bien souvent, j’aimerais vivre la vie d’un.e autre. Je parle peu et je ne sais pas quoi faire avec mes mains, je suis gênée chaque fois quand j’ai des interactions avec quelqu’un. Je n’ai des sentiments pour personne et pour rien, même si je souhaite les avoir. Quand je sens quelque chose, c’est bien fort, qu’il s’agisse de l’attachement ou de l’antipathie. Il n’y a rien entre les deux et les sentiments peuvent changer plusieurs fois par jour. Je sens un vide permanent. Des fois je parle seule dans les toilettes d’un bistrot. Lorsque l’on me prend en photo, je fais toujours très attention à ce que l’on ne voie pas sur mon visage combien je me sens incommode et inerte.
Pendant les conversations, je suis persuadée de savoir à ce que l’interlocuteur.trice pense ou ce qu’il.elle croit sur moi. Et si un échange ne s’est pas bien passé, de mon point de vue, le dialogue dans son ensemble se répète dans ma tête et j’ai le désir fort de quitter mon corps et de me cacher. Chaque remarque négative reste avec moi et elle revient quand je suis de mauvaise humeur, de manière soudaine, intense et involontaire avec tous les autres souvenirs négatifs, sous la forme des voix et des images.
Ce que je souhaite le plus est de me calmer, que cette lutte intérieure, fatigante, avec mes pensées arrête et que je m’échappe au rêve que je fais chaque nuit depuis un an : je rêve que je rêve que je rêve, c’est-à-dire le rêve est subordonné à un autre rêve, je vais être tuée et je ne peux pas m’échapper. J’arrive plus haut dans la hiérarchie des rêves puisque je sais que je rêve, mais c’est une longue lutte jusqu’à ce que je me réveille, jusqu’à ce que je sorte des profondeurs et j’arrive à la surface. Je me réveille la nuit, j’ai peur. Je crains fermer les yeux pour ne pas rester bloquée à nouveau dans le rêve.
Bien des fois, je veux renoncer à la vie. Et quand cette pensée disparaît, elle est remplacée par une autre : je vais mourir puisque c’est ce que j’ai souhaité. Mon image de moi-même est instable (soit j’arrive à m’accepter, soit je me déteste la minute suivante). Je crois ne jamais être assez bonne, je veux m’échapper au poids de mon secret, je souhaite être honnête et pouvoir dire que j’ai la schizophrénie pour que les gens comprennent. Bien des fois des gens dont j’ai à peine fait la connaissance me demandent : « Pourquoi tu ne dis rien ? », « T’es étrange toi, pourquoi tu ne t’exprimes pas ? »
A un moment donné j’ai dit à mon petit ami qu’il me fallait prendre une pause de la fac. Sa réponse a été que ce n’était qu’un prétexte pour m’en tirer plus facilement et que j’étais une grosse fainéante. Il m’a dit que j’étais faible et que je n’étais pas prête à devenir maman si je renonçais dans des situations si banales. Mais finalement, à une personne atteinte de diabète tu ne lui dis pas : « T’as pas honte toi ? Comment ne pas gouter le gâteau que j’ai fait ? ». A cause des pensées critiques, le sentiment le plus fort que j’ai c’est la honte.
La réalité je la vois par le filtre d’un écran fabriqué par mon cerveau et je me demande des fois combien de moi est la schizophrénie. Les pensées sont les miennes et elles me semblent normales ; c’est difficile à me dire que ce que je crois n’est pas réel ou me calmer puisqu’il n’y a rien à craindre. Je sais que je suis quelqu’un dans ma chambre et quelqu’un de différent dans la présence des autres. Il m’est difficile de me faire des amis ou d’échanger avec des connaissances, je me sens étrange par rapport à moi-même, je suis assez chaotique et s’il y a quelque chose qui ne va pas, pour moi rien ne va.
Je n’ai pas de plans pour l’avenir, je n’imagine jamais ce qu’il y aura dans cinq ou dix ans. La seule préoccupation est pour demain, que demain je sois OK. J’écoute beaucoup de musique et j’aime danser, alors j’arrive à me détacher complétement, à n’avoir aucune pensée. Il ne reste que la musique et le corps. Des fois, je sens une espèce d’attachement pour la maladie puisque j’ai l’impression que c’est la seule chose réelle que j’ai.
La majorité des aspects, des histoires, des situations décrites ci-dessus est déjà impersonnelle et se ressemble à un enregistrement à force d’être racontée tant des fois aux médecins, aux psychologues et aux psychothérapeutes. Je n’en parle à personne puisque je crains ce qu’ils croiront et diront sur moi quand je ne suis plus là.
Les gens parlent de la santé mentale sans s’en rendre compte ce qu’ils disent. Je les entends : « Je ne comprends pas pourquoi se gêner d’aller voir un psychologue. C’est normal de fréquenter un psychologue, on n’est pas dingue si on le fait. Les cinglés vont chez le psychiatre. » Le masque me fatigue « Tout va bien ». Je souhaite être comme les autres, que tout soit simple : les conversations, les bières entre amis, les nuits en ville. J’essaie vivre ainsi, mais c’est un échec chaque fois.
La maladie me détruit, mais, en même temps, je souhaite rester tout le temps ainsi puisque je suis convaincue avoir été choisie spécialement pour ce rôle. Alors je me demande : « C’est uniquement dans ma tête ? », « Oui, c’est uniquement dans ma tête. » , « Non, ce n’est pas possible », « Si, et tu le sais. », « Non. », « Si. ». C’est un tourbillon de pensées impossible à contrôler dont il faut que je m’échappe afin de pouvoir me concentrer sur ce que j’ai à faire.
Dans la plupart des cas je n’y arrive pas ; je vois le temps qui me reste à réviser pour l’examen passer et je continue à pleurer. Pendant que j’essaie de me calmer, je me rappelle une solution. C’est la solution qui apparaît chaque fois quand il y a la pression : « Je pourrais prendre plus de pilules. » La pensée est tout de suite suivie par une lutte intérieure où, une partie de moi dit que ce n’est pas la meilleure des idées et l’autre que si, car si je le fais, je m’en sors. Je me rappelle ensuite que maman sait ce qu’il m’arrive, mais je ne peux pas l’appeler pour qu’elle ne s’inquiète. Je sais que je suis la seule qui peut me sauver, mais c’est si difficile. Et alors je me sens si seule à nouveau.

Le trouble que j’ai, la schizophrénie, est une maladie qui touche 1% de la population. Dans la période 2016-2018, en Roumanie, environ 7.500 nouveaux cas de schizophrénie ont été diagnostiqués (selon les données déclarées par les médecins de famille). Un sur sept jeunes avait moins de 30 ans (source : le Ministère de la Santé). Les causes de la schizophrénie ne sont pas connues. Les scientifiques estiment qu’il s’agit d’un mix de facteurs qui mènent à l’apparition de la maladie. Un serait génétique, si le patient a un parent avec le même diagnostique. Un autre est représenté par les traumas du passé ou du milieu de vie. Le déséquilibre biochimique au niveau du cerveau ou la consommation abusive de substances psychoactives peuvent eux aussi mener à la schizophrénie. Dans la majorité des cas, il est difficile à définir quand l’état du patient s’est dégradé jusqu’à ce qu’il doive s’y rendre chez le médecin, puisqu’il s’agit d’un changement graduel et subtile. Parmi les symptômes, on compte les idées qui ne reflètent pas la réalité, les pensées anormales, les soupçons, les hallucinations (symptômes positifs), l’apathie, la diminution de l’expressivité, l’aplatissement des émotions (symptômes négatifs) et des problèmes de concentration et de mémoire (symptômes cognitifs). Dans le cas de la schizophrénie, bien des fois le nom de la maladie et les aprioris y associés nous effraient, mais elle est une maladie comme toute autre, qui requiert un traitement et qui ne définit pas le patient. Un diagnostic précoce est important, puisque c’est un trouble qui peut s’aggraver avec le temps. Il est important de parler de ses ressentis et de demander de l’aide, d’être honnêtes avec nous-mêmes et avec le médecin, de ne pas cacher des choses et de ne pas s’isoler. Le rôle des médicaments est d’aider le patient à gérer les symptômes et d’arrêter leur réapparition (les symptômes peuvent disparaître totalement ou partialement). Un des pièges est de renoncer tout seul au traitement quand on se sent bien (ce genre de décisions doivent être prises avec le médecin). Le plus important est d’accepter le trouble et le fait que nous avons besoin d’aide.
Chaque fois quand j’écoute une de mes chansons préférées sur YouTube, je lis un des commentaires de quelqu’un qui dit que sa maman avait des problèmes psychiques et qu’elle avait du mal à rester en vie à causes des problèmes crées par la maladie. J’aime lire ce commentaire puisque, souvent, c’est ce que je ressens. Il est vrai, nombreuses sont les situations dominées par la solitude, par l’idée que cela ne finit jamais et qu’il faut que tu saches comment te remettre seul. Je ne connais pas la réponse à la question « Comment ? » ou « Quoi faire ? », mais je pense que bien des fois la lutte est contre la conviction que t’es tout seul. C’est pour cela qu’il est important de parler sur comment on se sent, de demander ou d’offrir de l’aide et de comprendre que ce n’est pas une lubie, une excuse ou un trait étrange, il ne s’agit pas de chercher l’attention, de paresse ou de folie, c’est juste une maladie qui doit être traitée.
*L’auteure de cet article a décidé de rester anonyme puisque la santé mentale reste un sujet tabou en Roumanie.
Naomi Bîldea, l’illustratrice de l’article, a 18 ans et elle est élève au Collège National « Frații Buzești » de Craiova
Éditrice du texte : Elena Stancu
Traduction en français : Claudia Davidson-Novosivschei
Révision de la traduction : Cristina Hagău
(1) L’équivalent de la 6e dans le système scolaire français (note de la traductrice).
(2) L’équivalent de la 5e dans le système scolaire français (note de la traductrice).
(3) L’équivalent de la 3e dans le système scolaire français (note de la traductrice).
(4) L’équivalent de la 2nde dans le système scolaire français (note de la traductrice).
(5) L’équivalent de la 3e dans le système scolaire français (note de la traductrice).
Le texte et les illustrations ont été réalisés dans le cadre du projet “Gen, revista” (« Genre, magazine »), soutenu par l’Institut français de Roumanie. Le magazine est un projet de Forum Apulum, une association civique d’Alba Iulia, créée pour former de nouvelles générations de citoyens informés et impliqués, prêts à changer le monde pour le mieux.
Si vous voulez que ce projet se poursuive et que les jeunes écrivent, dessinent et photographient des sujets qui leur tiennent à cœur, vous pouvez nous soutenir à travers l’une des méthodes suivantes.
Partager l’article:





